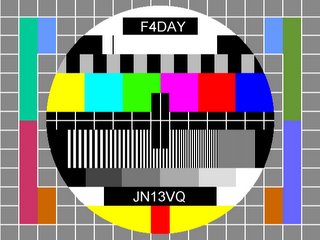Invités à échanger, hommes de presse, dirigeants politiques et lobbyistes ont souligné la nécessité de repenser les canaux de production et de diffusion des idées neuves en France. L’occasion de s’interroger sur le rôle joué par les « Think tanks » français.
« Les idées neuves sont récompensées par le système médiatique, usées par le système institutionnel, punies par le système partisan ».
Tout est dit de la difficulté de faire émerger puis accepter une idée nouvelle en France. La phrase de Christophe Barbier, Directeur adjoint de l’Express, fait mouche. Elle rappelle que, dans la course aux idées, la France a pris plusieurs longueurs de retard. Ailleurs, aux Etats-Unis très largement, en Allemagne aussi, l’offre est structurée autour de grands centres de recherches, véritables « réservoirs », gros pourvoyeurs de réflexions en matière de politique publique. Ces « fournisseurs de créativité », placés en amont de l’activité politico-administrative, sont les dépositaires d’une certaine innovation politique. A l’instar des services recherche-développement dans l’entreprise, ils sont conçus comme la source de profits politiques futurs.
Les expériences allemande et américaine sont éclairantes pour la France. Elles montrent que la force d’un « think tank » se mesure d’abord à l’aune de sa puissance médiatique, de sa capacité d’influence. L’Heritage Foundation ou la Brookings Institution ont intégré ces dimensions depuis longtemps, en disposant de leurs propres studios d’enregistrement. La leçon américaine est à méditer. Outre-atlantique, on a compris que la bataille des idées est d’abord celle des moyens mis en oeuvre pour leur diffusion
C’est à cette seule condition – d’exister médiatiquement, donc politiquement – que les idées issues de la recherche des « think tanks » ne restent pas seulement des idées mais qu’elles trouvent une traduction politique concrète soit dans l’action gouvernementale soit dans les programmes électoraux des partis de gouvernement. C’est tout le sens des interventions du Dr. Michael Eilfort, directeur du très influent Stiftung MarktWirtschaft de Berlin et Véronique de Rugy, chercheur à l’American Enterprise Institute (AEI), qui ont particulièrement insisté sur la grande perméabilité existant dans leurs pays, entre monde politique et « think tanks ».
De ce point de vue, les « thinks tanks » français souffrent encore de la faible pénétration de leurs idées dans le monde politique. Les chercheurs sont des penseurs avant d’être des diffuseurs, pis encore, ils sont très souvent uniquement des penseurs, oubliant d’être des diffuseurs. Une nouvelle stratégie de communication, intégrant d’autres supports que leurs seules publications, envisageant de nouvelles cibles, en particulier les dirigeants économiques, doit être pensée. Les revues académiques, éditées par et pour des cercles de réflexion restreints souffrent d’une trop grande confidentialité et d’un manque d’exposition. Les articles publiés dans ces revues d’influence ne sont pas ou insuffisamment repris dans la presse, inexistants ou presque à la télévision. Aux Etats-Unis, les directeurs de « think tanks » sont invités quasi quotidiennement à commenter l’actualité sur les grands réseaux nationaux, faisant ainsi coup double, en promouvant leurs idées et leurs institutions.
Le temps est peut-être venu pour les « think tanks » français de passer du « B to B » (leaders d’opinions - leaders d’opinions) au « B to C to B» (leaders d’opinion – grand public – leaders d’opinions). Il leur faut envisager les moyens d’une vraie communication grand public. Et faire enfin le pari d’une plus grande visibilité, d’une plus grande influence sur les décideurs publics aussi !
« Les idées neuves sont récompensées par le système médiatique, usées par le système institutionnel, punies par le système partisan ».
Tout est dit de la difficulté de faire émerger puis accepter une idée nouvelle en France. La phrase de Christophe Barbier, Directeur adjoint de l’Express, fait mouche. Elle rappelle que, dans la course aux idées, la France a pris plusieurs longueurs de retard. Ailleurs, aux Etats-Unis très largement, en Allemagne aussi, l’offre est structurée autour de grands centres de recherches, véritables « réservoirs », gros pourvoyeurs de réflexions en matière de politique publique. Ces « fournisseurs de créativité », placés en amont de l’activité politico-administrative, sont les dépositaires d’une certaine innovation politique. A l’instar des services recherche-développement dans l’entreprise, ils sont conçus comme la source de profits politiques futurs.
Les expériences allemande et américaine sont éclairantes pour la France. Elles montrent que la force d’un « think tank » se mesure d’abord à l’aune de sa puissance médiatique, de sa capacité d’influence. L’Heritage Foundation ou la Brookings Institution ont intégré ces dimensions depuis longtemps, en disposant de leurs propres studios d’enregistrement. La leçon américaine est à méditer. Outre-atlantique, on a compris que la bataille des idées est d’abord celle des moyens mis en oeuvre pour leur diffusion
C’est à cette seule condition – d’exister médiatiquement, donc politiquement – que les idées issues de la recherche des « think tanks » ne restent pas seulement des idées mais qu’elles trouvent une traduction politique concrète soit dans l’action gouvernementale soit dans les programmes électoraux des partis de gouvernement. C’est tout le sens des interventions du Dr. Michael Eilfort, directeur du très influent Stiftung MarktWirtschaft de Berlin et Véronique de Rugy, chercheur à l’American Enterprise Institute (AEI), qui ont particulièrement insisté sur la grande perméabilité existant dans leurs pays, entre monde politique et « think tanks ».
De ce point de vue, les « thinks tanks » français souffrent encore de la faible pénétration de leurs idées dans le monde politique. Les chercheurs sont des penseurs avant d’être des diffuseurs, pis encore, ils sont très souvent uniquement des penseurs, oubliant d’être des diffuseurs. Une nouvelle stratégie de communication, intégrant d’autres supports que leurs seules publications, envisageant de nouvelles cibles, en particulier les dirigeants économiques, doit être pensée. Les revues académiques, éditées par et pour des cercles de réflexion restreints souffrent d’une trop grande confidentialité et d’un manque d’exposition. Les articles publiés dans ces revues d’influence ne sont pas ou insuffisamment repris dans la presse, inexistants ou presque à la télévision. Aux Etats-Unis, les directeurs de « think tanks » sont invités quasi quotidiennement à commenter l’actualité sur les grands réseaux nationaux, faisant ainsi coup double, en promouvant leurs idées et leurs institutions.
Le temps est peut-être venu pour les « think tanks » français de passer du « B to B » (leaders d’opinions - leaders d’opinions) au « B to C to B» (leaders d’opinion – grand public – leaders d’opinions). Il leur faut envisager les moyens d’une vraie communication grand public. Et faire enfin le pari d’une plus grande visibilité, d’une plus grande influence sur les décideurs publics aussi !